Tournoi de jeu d'échecs


Philosophie[1] du « Joueur d’échecs » au Collège du Christ-Roi
Jeu de bataille, terrain de conquête, stratégie de combat, le « Joueur d’échecs » est le général d’une armée composée de deux fous, deux tours, deux cavaliers, huit petits soldats appelés pions (petits mais costauds). Sans oublier une Dame toute puissante dans ses déplacements et un Roi à défendre. 16 pièces à mobiliser avec tact et prudence. L’échiquier comme terrain de jeu auquel le « Joueur d’échecs » respecte trois phases essentielles : créer les ouvertures, développer son jeu, finaliser l’opération. Il travaille son plan et planifie son travail.
Comme dans la vie et en fonction de la situation, le « Joueur d’échecs » doit prendre des décisions, s’organiser, se mobiliser, assumer ses responsabilités et se remettre en question. Le « Joueur d’échecs » favorise la rencontre et le partage car il sait qu’ils sont une nécessité pour jouer, sans l’autre il n’y a pas de partie !
Comme les sports de compétition, le jeu d’échecs est un jeu où l’on retrouve des perdants et des gagnants. Chaque coup porté a son lot de conséquences.
Il maintient une ligne de conduite pour atteindre ses objectifs. Il sait qu’il croisera sur son chemin Monsieur Plaisir et Madame Frustration. Ces derniers peuvent être des moteurs ou des freins dans son parcours. Malgré tout, il ne se laisse pas abattre aussi facilement, il apprend à relativiser ses combats et à affiner son jeu.
Le « Joueur d’échecs » grandit de ses erreurs et de ses succès. Tantôt gagnant, tantôt perdant, il comprend que c’est en jouant qu’il perfectionne son jeu. Il s’accorde le droit de faire des erreurs car il sait que cela fait partie de l’apprentissage.
Le « Joueur d’échecs » préconise l’art et la manière avec son Partenaire-Adversaire.
Pour le « Joueur d’échecs »,l’autre n’est pas la personne « à abattre » mais à élever, à outiller afin de la préparer à des rencontres équilibrées.
Il sait que le but du jeu n’est pas une fin en soi (gagner ou perdre), il comprend que la beauté du geste (approche esthétique : développer de belles combinaisons dans son jeu) fait partie d’une chorégraphie mentale qui se matérialise sur l’échiquier.
Le « Joueur d’échecs » doit s’armer d’humilité, dompter son égo et respecter son Partenaire-Adversaire car tout est relatif.
Le « Joueur d’échecs » accepte ses capacités (construites à partir de son degré d’implication) de jeu ainsi que celles du Partenaire-Adversaire.
Il profite des moments de plaisir et de satisfaction comme il apprend à gérer ses frustrations et à accepter ses erreurs.
Le « Joueur d’échecs » partage ses victoires et ses défaites avec son Partenaire-Adversaire afin d’en tirer des leçons.
Il sait que pour construire son jeu et viser la victoire, il doit mobiliser différents leviers (le respect, la patience, la concentration, les techniques d’apprentissage…).
Le « Joueur d’échecs » encourage son autonomie et son indépendance sur l’échiquier (libre choix des décisions, mesure les conséquences des liens de cause à effet, développe la responsabilité individuelle) mais, il n’hésite pas à demander des conseils à un autre Joueur pour perfectionner son jeu.
La Philosophie du « Joueur d’échecs » peut être alimentée par d’autres productions écrites émanant des « Joueurs d’échecs ». Ils aiment partager leurs inspirations créatrices que génère le jeu d’échecs.
Antonio Rizzo
[1] La Philosophie du « Joueur d’échecs » est un construit qui émane de plusieurs lectures, d’observations, de rencontres (joueurs de différents niveaux de jeu et formateurs), d’une expérience personnelle et sociale autour de l’échiquier. Son contenu prône des valeurs indispensables à une approche humaniste du jeu.
[1] La Philosophie du « Joueur d’échecs » est un construit qui émane de plusieurs lectures, d’observations, de rencontres (joueurs de différents niveaux de jeu et formateurs), d’une expérience personnelle et sociale autour de l’échiquier. Son contenu prône des valeurs indispensables à une approche humaniste du jeu.
Règlement pour le « Joueur d’échecs »
Le « Joueur d’échecs » respecte les règles et le matériel du jeu.
Il prend en considération la Philosophie du « Joueur d’échecs. »
Il s’engage à respecter ses encadrants et ses condisciples.
Il favorise les rencontres entre ses pairs et son entourage.
Il s’engage à élever son Partenaire-Adversaire pour élever son jeu.
Il respecte et remercie le joueur d’échecs en lui serrant la main au début et à la fin de la partie.
Il respecte les silences et les choix de son Partenaire-Adversaire.
Il valorise ses efforts et sa persévérance ainsi que ceux de son Partenaire-Adversaire.
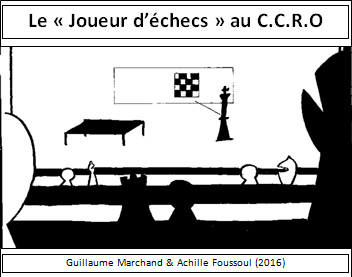
« Les échecs sont utiles à l'exercice de la faculté de penser et à celle de l'imagination. Car nous devons posséder une méthode élaborée pour atteindre des buts partout où nous devons conduire notre raison. » Leibnitz
Pratiqué à tous les âges, le jeu d'échecs connaît une grande expansion dans les établissements scolaires en Belgique mais aussi, en Europe et dans le reste du monde.
Aujourd’hui, les vertus éducatives du jeu d'échecs ne sont plus à démontrer.
En effet, selon Maurice Ashley (« La diagonale du succès »), les échecs permettent de développer une pensée logique ; d’améliorer la capacité à résoudre des problèmes ; d’améliorer l’attention et la concentration ; d’épanouir l’imagination et la créativité ; de développer la capacité à prévoir les conséquences d’une action ; d’encourager l’autonomie et la responsabilisation ; de favoriser la mémoire ; de renforcer la confiance en soi ; de comprendre que c’est souvent sur le long terme que l’on est récompensé de ses efforts.
Fort de ce constat et suite aux demandes de nos élèves qui ont manifesté une réelle motivation pour intégrer le jeu d’échecs au sein du Collège Christ-Roi, nous avons mis à leurs dispositions, depuis mars 2016,un espace commun d’apprentissage au jeu d’échecs et ce, peu importe l’âge, la classe et le sexe de l’élève.
Nos collégiens sont encadrés sur le temps de midi par un éducateur référent ayant suivi une formation spécifique. Il favorise l’apprentissage par les pairs en prenant en considération trois catégories de jeunes motivés (élaborées, suite aux remarques des élèves) : les débutants (« Je ne sais pas jouer mais j’ai envie d’apprendre »), les intermédiaires (« Je connais les règles du jeu mais j’aimerais évoluer ») et les expérimentés (« Je joue depuis quelques années, j’aimerais partager cette passion avec les élèves de mon école »).
Enfin, une philosophie du « Joueur d’échecs » et un règlement balisent la dynamique des rencontres.